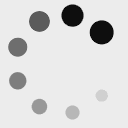Les films de Harun Farocki
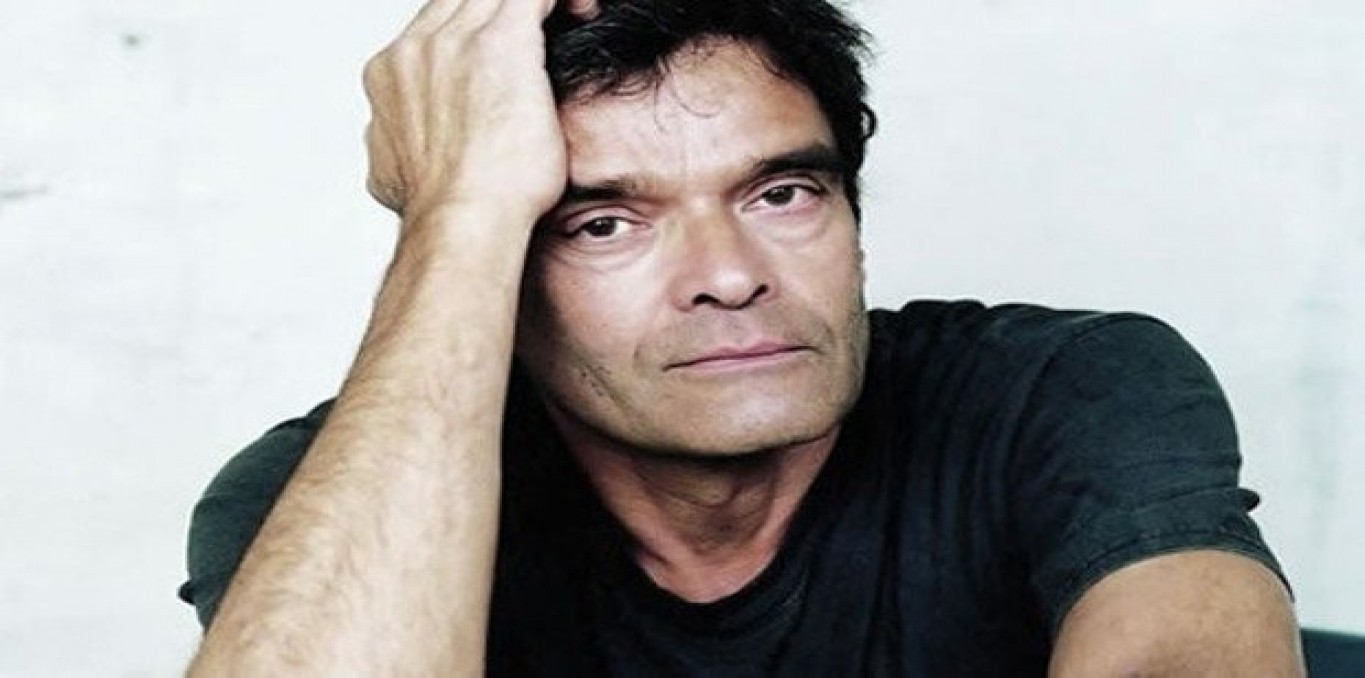
« Nous voulons investir une forme de cinéma qui exhorte à la liberté d'esprit, qui ne se laisse pas subordonner au journalisme, au divertissement, aux sciences et à l'art. » Harun Farocki, 1987
« Nous voulons investir une forme de cinéma qui exhorte à la liberté d'esprit, qui ne se laisse pas subordonner au journalisme, au divertissement, aux sciences et à l'art. » Harun Farocki, 1987
Né en 1944 dans le protectorat de Bohême-Moravie (aujourd'hui République Tchèque), Harun Farocki fit partie, aux côtés, entre autres, d'Hartmut Bitomsky et d'Helke Sander, de la première promotion de la dffb – la Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin. Comme beaucoup, Farocki en fut renvoyé en 1968.
Harun Farocki a d'abord défendu un cinéma ouvertement militant, dont son deuxième film, Feu inextinguible (Nicht löschbares Feuer, 1969) est un exemple remarquable. Pamphlet contre l'usage du napalm, le cinéaste y démontre le rôle de l'industrie dans la production des armes chimiques, et par là la responsabilité et les intérêts capitalistes dans la guerre. Une méthode critique s'élabore sous nos yeux : comment montrer, représenter, faire comprendre la violence ? S'y dessinent les enjeux politiques et esthétiques que l'ensemble de son œuvre entreprendra d'explorer, à travers plus de cent films, et d'une dizaine d'installations, format vers lequel il se tourne à partir de 1995 jusqu'à la fin de sa vie, en 2014.
Penseur, Farocki est à l'origine de nombreux textes et essais, publiés en France pour un certain nombre d'entre eux dans la revue Trafic et fut également, de 1974 jusqu'à la fin de la revue en 1984, membre du comité de rédaction de Filmkritik – équivalent allemand des Cahiers du Cinéma. Il est également l'auteur d'un ouvrage, Von Godard Sprechen (1998), dans lequel il dialogue avec la théoricienne Kaja Silverman à propos de Jean-Luc Godard dont l'œuvre, comme celle de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, revêtit une importance fondamentale pour son cinéma.
L'observation directe et l'archive sont les deux modalités selon lesquelles Harun Farocki appréhende le réel. Film après film, le cinéaste élabore une méthode cinématographique, toujours critique, qui se fonde sur un montage analytique lui permettant de démonter les discours que portent les images et ceux qui les accompagnent, allant « à la recherche de leur sens enseveli* ». Avec exigence et précision, Farocki a construit en quarante ans une œuvre singulière qui, en s'intéressant aux conditions de production et de circulation des images, donne à penser « les interactions sociales entre guerre, économie et politique sur la toile de fond d'une histoire audiovisuelle de la civilisation et des techniques* », attentive, toujours, aux mutations sociales et médiatiques, en cours ou à venir.
Sources et ressources :
Aux bords du documentaire, Harun Farocki, P.O.L, 2022
* Reconnaître et poursuivre, Harun Farocki, textes réunis et introduits par Christa Blümlinger, TH.TY, Centre Pompidou, 2017
Cinémas profanes. Straub-Huillet, Harun Farocki et Pedro Costa : une constellation, Thomas Voltzenlogel, Presses universitaires de Strasbourg, 2018
Jeux sérieux, cinéma et art contemporain transforment l'essai, Bertrand Bacqué et al. (dir.), mamco/HEAD, 2015
Remontages du temps subi, Georges Didi-Huberman, Les Editions de Minuit, 2010
3 documentaires

Une journée dans la vie d'un consommateur final
Une journée dans la vie d'un consommateur final
Accès abonnementÀ quoi rêve la publicité ? Harun Farocki puise dans quarante ans d'images télévisées pour reconstruire une journée idéale de la vie d'un consommateur.

La Vie RFA
Peu avant la réunification de l'Allemagne, Harun Farocki s’est rendu dans de nombreux centres de formation ou d’entraînement en Allemagne (compagnie d’assurances, école de sages-femmes, école de police, etc.) pour dévoiler leur fonctionnement. Il y fait apparaître les règles qui régissent la société ouest-allemande à la fin des années 1980.

Images du monde et inscription de la guerre
Images du monde et inscription de la guerre
Accès abonnement_Images du monde et inscription de la guerre_ est un essai dont le motif central est la photographie aérienne du 4 avril 1944 du camp d’Auschwitz prise par un avion de reconnaissance états-unien. Sur cette photographie, les analystes identifièrent les usines environnantes mais pas le camp de concentration et d’extermination.

Une journée dans la vie d'un consommateur final
Une journée dans la vie d'un consommateur final
Accès abonnementÀ quoi rêve la publicité ? Harun Farocki puise dans quarante ans d'images télévisées pour reconstruire une journée idéale de la vie d'un consommateur.

La Vie RFA
Peu avant la réunification de l'Allemagne, Harun Farocki s’est rendu dans de nombreux centres de formation ou d’entraînement en Allemagne (compagnie d’assurances, école de sages-femmes, école de police, etc.) pour dévoiler leur fonctionnement. Il y fait apparaître les règles qui régissent la société ouest-allemande à la fin des années 1980.

Images du monde et inscription de la guerre
Images du monde et inscription de la guerre
Accès abonnement_Images du monde et inscription de la guerre_ est un essai dont le motif central est la photographie aérienne du 4 avril 1944 du camp d’Auschwitz prise par un avion de reconnaissance états-unien. Sur cette photographie, les analystes identifièrent les usines environnantes mais pas le camp de concentration et d’extermination.