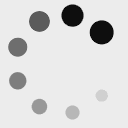L'enchantement documentaire
Cette année marque la 30e édition des États généraux du film documentaire de Lussas. L'occasion de vous proposer un parcours en 9 films passés par ce rendez-vous non-compétitif qui s'est toujours fait l'écho des mouvements tectoniques de la planète cinéma. En effet, j'ai choisi ces films pour leurs qualités intrinsèques, chacun représente un courant, un mouvement ou un symptôme qui a marqué l’évolution des formes documentaires.
Mais d'abord quelques éléments sur les origines de la manifestation.
Tout a commencé par un film documentaire que nous avions réalisé avec quelques copains en Cévennes sur la tradition orale. Montrer ce film seul nous paraissait un non sens, alors nous avons décidé d’organiser en 1978 un festival à Lussas qui s’intitulerait "Cinéma des pays et régions". Tout ce qui se faisait de cinéma indépendant et politique était au rendez vous au point que très vite les films sur Lip, le Larzac, Malville, Plogoff, le MLAC, les films tiers-mondistes… étaient au cœur de notre programmation, mais également des essais plus incertains avec une dominante documentaire. Rendez-vous des productions naissantes en région et de structures de production indépendantes parisiennes, un réseau de complicités autour du documentaire était né.
Je participais à la création d’une association sur Paris durant l’hiver 1984-1985. "La bande à Lumière" regroupait des réalisateurs producteurs indépendants pour beaucoup issus du cinéma documentaire politique des années 70. Constatant avec la multiplication des TV et l’avènement de la vidéo qu’une époque et une économie nouvelle se dessinait, nous étions convaincus que le documentaire devait en être et qu’il y avait donc nécessité à mettre en lumière ce "genre".
Deux projets virent le jour au sein de l’association. Le premier, proposé par Olivier Masson, fût la création de la Biennale européenne du documentaire de Lyon en janvier 1989 qui deviendra un an plus tard le Sunny Side of the Doc de Marseille. Pour le deuxième, avec le soutien de quelques uns de la bande, je proposais la création des États Généraux du documentaire à Lussas pour août 1989. L'idée était de créer un temps où l’on verrait des films choisis sans créer de prix ni de compétition. Un temps de réflexion, considérant que les différentes formes de cinéma sont avant tout de la pensée. En pleine campagne, Lussas offrait ainsi une sorte d’extraterritorialité : un temps de rupture propice aux rencontres et aux échanges dénués de toute mondanité.
Jean-Marie Barbe,
Cofondateur des États généraux du film documentaire et de Tënk

Cette programmation est soutenue par la Cinémathèque du documentaire.
À la Bande à Lumière, nous nous étions choisi comme président Joris Ivens qui avait accepté à la condition d’être un président actif. Emblème, s’il en était, d’un cinéma documentaire politique qui avait accompagné les révolutions du siècle, il avait réalisé en particulier avec sa compagne Marceline Loridan au milieu des années 70 une fresque documentaire sur la Chine de Mao "Comment Yukong déplaça les montagnes".
À 90 ans, il venait de tourner un nouveau film en Chine "Une histoire de vent". Voici ce que Joris déclarait :
"Je n’ai jamais eu une double personnalité, d’un côté l’artiste, et de l’autre le militant. La poésie a toujours été là, comme un sous courant. Mais au XXe siècle, si tu ne t’es pas préoccupé des problèmes du monde, quel artiste es-tu ? Il ne s’agit pas d’un sacrifice. Dans la forme d’art que j’ai choisie, on doit avoir l’émerveillement des choses, de la vie et des autres…"
Bien sûr il convient aujourd’hui de regarder ce film comme une œuvre de ciné-club. Le voir avec nos yeux de 2018, c’est constater qu’il garde des moments magiques, alors que certaines séquences résistent moins bien au temps.
Mais il reste néanmoins une valeur iconique ! Probablement sublimée par la figure même de Ivens mais aussi par les différentes strates du film : celle d’un cinéma qui emprunte à la fiction comme au documentaire, celle d’un autoportrait où le réalisateur intègre le processus de fabrication du film au film lui-même et mêle éloge de la Chine éternelle (au risque d’être parfois dans la carte postale d’elle-même) à la critique d’une Chine où tout s’achète, une Chine qui s’était déjà ouverte au marché.
Finalement pour développer une métaphore qui tient lieu de scénario : la recherche de l’air, du vent, du souffle de vie.
Dans une photo prise en août 1990 lors de la deuxième édition des États généraux du Documentaire, Rithy Panh est à la tribune du premier atelier coordonné magnifiquement par Marie-Pierre Duhamel-Muller et Yann Lardeau. Le thème est "Documentaire et éthique". Il cite Hannah Arendt dans "Du mensonge à la violence" :
"Il est si facile et si tentant de tromper. La tromperie n’entre jamais en conflit avec la raison, car les choses auraient pu se passer effectivement de la façon dont le menteur le prétend. Le mensonge est souvent plus plausible, plus tentant pour la raison que la réalité, car le menteur possède le grand avantage de savoir d’avance ce que le public souhaite entendre ou s’attendre à entendre... Tandis que la réalité a cette habitude déconcertante de nous mettre en présence de l’inattendu, auquel nous n’étions nullement préparés"
Voilà un cinéaste clef de ces 30 dernières années. Rithy Panh est dans l’histoire du cinéma celui qui va faire parler les bourreaux mais on ne le sait pas encore ! Ce film, Les Gens de la rizière, arrive tôt dans son œuvre. C’est surtout sa première fiction, probablement nécessaire à ce moment là pour commencer à raconter l’inracontable.
Ce que ce film commence à tisser, c’est le canevas de l’histoire du Cambodge qui emmènera Rithy et son cinéma à être à la fois une sorte de conscience et de repère dans ce pays déboussolé.
On ne peut se reconstruire, accéder au rang d’humain, comprendre l’ignominie, que quand le criminel met des mots sur ces actes. Quand le bourreau parle, il devient alors humain et permet à la victime de sortir de la sidération.
Nous avons projeté depuis la plupart des films de Rithy aux États Généraux et nous les montrerons tous sur Tënk au cours des années à venir.
Probablement un des films les plus inoubliables sur l’acte de création.
Nous avons rencontré l’œuvre de Víctor Erice en 1995 en même temps que nous célébrions l’intégrale de Kiarostami aux États Généraux de la même année. Et surprise, en 2008, sous l’impulsion de Alain Bergala à Beaubourg à Paris a eu lieu une exposition-installation où les deux maîtres dialoguaient à travers leurs œuvres et leur correspondance-vidéo.
L’enchantement que fut la découverte de ce film "Le Songe de la lumière" est probablement liée à plusieurs facteurs mais l’idée de tenter de filmer le temps y est totalement accomplie et, avec elle, son cortège de puissance : la finitude, la fonction de l’art, la contemplation du temps naturel, le cinéma comme mémoire, pour qui sait attendre.
Encore un film qui au début des années 2000 n’avait d’autre issue que d’être dans le ghetto des courts métrages que personne, ou presque, ne pouvait voir, ni au cinéma ni à la télévision. Mais aujourd’hui, la révolution numérique les appelle "formats courts" et ils sortent enfin de l’anonymat. À Tënk, nous en inventons chaque semaine.
Avec "Undressing My Mother", Ken Wardrop franchit avec élégance l’interdit du corps vieilli. J’aime ce film pour sa hardiesse, son humanité et probablement sa mélancolie. Quelle incroyable foi dans le cinéma et dans la complicité mère-fils pour un dévoilement qui pourrait être impudique mais qui, à aucun moment, ne bascule.
Cette œuvre nous donne accès à l’intimité d’un corps marqué par l’âge, mais un corps aimé et raconté par celle qui l’habite et qui le décrit. Comme si ce corps était porteur du regard aimant de son compagnon disparu. On entend alors le "je l’ai dans la peau" comme "j’ai la mémoire de son regard sur ma peau". Tout est affaire de regard !
Le choix du film de Ludivine Henri est porteur de plusieurs significations. C’est d'abord le film d’une étudiante du Master crée à Lussas en 2000 en partenariat avec l’Université de Grenoble. Une génération de cinéastes documentaires a désormais un lieu, une histoire, une culture du présent et de l’avenir. Et bonne nouvelle : l’Université au XXIe siècle forme désormais en de multiples facs des documentaristes.
Ce film tourné et monté quasiment seule incarne également, pour une part, ce mouvement apparu avec l’arrivée de la vidéo légère : le film intimiste, le journal intime qui est l’une des plus fortes secousses telluriques de ces trente ans.
Mais le film est bien loin d’être seulement l’archétype d’une forme. Dans un plan séquence qui compose l’essentiel du film, la réalisatrice et sa mère sont face camera. Devant nous, se joue en silence ou à demi-mot un appel, une demande de geste d’amour qui ne viendra pas. Rien ne se passera !
C’est dans cette sobre mise en scène que le film nous reste en mémoire. Il nous renvoie probablement à l’avalanche des rendez-vous manqués, à ces occasions ratées, à ces gestes d’amour que l’on n’a pas su recevoir ou que l’on n’a pas reçus. Il nous rappelle à une violence ontologique de l’image documentaire à l’endroit des personnes filmées. Le cinéma documentaire transforme l’anonyme en personne publique.
Quand Victor Kossakovsky fut invité aux États Généraux, quelques jours avant sa venue, nous recevions un message de panique : "Mais je ne trouve Lussas sur aucune carte du monde. Est-ce-qu’il existe ?"
Situation, un peu gênante pour probablement l’un des cinéastes documentaristes clef de la génération russe des années 1990-2000. Il trouvera finalement Lussas !
Pour ce film très construit, Victor Kossakovsky avait privé son fils depuis sa naissance de reflet, supprimant tout miroir dans la maison, attendant le jour où son fils serait en âge de marcher, jouer et être acteur de lui même.
Ce jour arrivé, le film tente de saisir ce moment premier de la découverte de sa propre image. Le film, dans cet énoncé, n’a donc rien d'exceptionnel, les psychanalystes ont étudié et théorisé le stade du miroir depuis bien longtemps.
Mais on comprend à la vision de Svyato qu’on aurait tort d’en être blasé tant le documentaire dans son déroulé nous donne à vivre cet instant originel et les différentes phases que l’enfant traverse en moins d’une heure.
Le spectacle de cette expérience est constitutif d’une fonction du cinéma et Kossakovsky s’en amuse. Reflets, ombres chinoises… assurément un voyage aux origines de l’image.
Il y a quelques mois Denis Freyd qui prépare le prochain film des Frères Dardenne confiait à Marianna Otero "Je ne sais plus produire ces films".
Que recouvre ce découragement ? À vrai dire, je ne le sais précisément. Peut-être l’impasse dans laquelle se trouve les producteurs pris entre la quasi disparition des financements TV et la difficulté rencontrée par les documentaires à l’avance sur recette cinéma. Pourtant, jamais les œuvres n’ont été aussi nombreuses et de qualité. La légèreté des outils ajoutée à la régression des conditions sociales de réalisation et de production font qu’à de rares exceptions, on ne peut plus vivre de ce métier mais que beaucoup continuent à l’exercer dans des conditions de précarité que seul l’engagement rend acceptable.
Entre nos mains est le film d’une cinéaste engagée qui s’intéresse à ce monde des ouvrières, monde oublié s’il en est, monde invisible car monde généralement interdit au cinéma documentaire sauf lorsque les travailleur.se.s prennent les rênes de leur usine. Précisément dans "Entre nos mains" Mariana filme la tentative de reprise de la structure par les salarié.e.s et ce que magnifie le film, c’est leur dignité. Ce qui compte, c'est de ne pas perdre son âme. L’expérience est dans le trajet, le parcours accompli. L’échec du résultat final n’est pas l’échec de l’expérience, au point que le film se termine par un chant choral comme si la mise en scène de fiction, venait panser les plaies de l’échec documentaire en ramenant du rêve, tout en célébrant le triomphe de l’expérience collective, de la vie contre le renoncement !
Des nouvelles d’un cinéaste Marseillais que nous avions accueilli il y a 38 ans lors des premiers festivals de Lussas. Alain Ughetto s’essayait alors avec talent à l’animation avec la pâte à modeler puis, pendant plus de trente ans, rien ! Avec Jasmine, voilà un retour plein de sens et de grâce. Son film s'inscrit dans l’un des mouvements de forme marquant de la décennie, en l’occurrence le métissage du documentaire et de l'animation mais aussi l'utilisation de l’image d’actualité, des archives papier ou sonore, du film de famille.
L’un des talents d’Alain Ughetto est de faire le pari que les différentes textures des images d’archives vont pouvoir se fondre avec la pâte à modeler. Il raisonne ainsi en plasticien : la matière fait lien, la texture des images comme des voix donne corps au film et en amplifie le sens.
Il est vrai que les cinéastes travaillent désormais avec un demi-siècle d’images. C’est un fleuve incessant et grandissant de films de toutes textures (pellicule, vidéo, magnétique, images numériques…) et de toute nature. La réappropriation et le détournement de toutes cette matière offrent de nouveaux possibles qui documentent l’époque et entre les mains des cinéastes donnent au documentaire une amplitude qu’il n’avait probablement jamais eu. Jasmine en est l’exemple accompli.
Mitra Farahani est peintre et filme la résurrection et, sans l’avoir voulu, la mort du grand peintre iranien Mohassess. Ce film aux multiples strates est probablement à la hauteur de l’œuvre du peintre qu’il célèbre, un florilège, une palette de niveaux de récit. La réalisatrice nous entraine dans un jeu permanent assez vertigineux de vrais évènements et de fausses pistes. Voyez plutôt :
En premier lieu, à partir de l’exposition-vente des œuvres, elle part à la recherche de l’artiste disparu depuis des décennies.
Puis l’ayant retrouvé, elle partage la fabrication de son film avec ce personnage libertaire et impertinent. On est alors dans un film à deux.
Dans le même temps, elle introduit et organise à l’insu du maître une commande de tableaux qui va organiser le récit du film et une partie de la tension du film.
Par ailleurs, avec l’écriture d’un commentaire, elle raconte les coulisses du projet comme une sorte de carnet de route qui permet le mélange des temporalités et donne une liberté de relance de la dramaturgie.
Vous l’aurez compris Mitra Farahani est diablement douée et son documentaire est un jeu permanent : un grand film pour célébrer un grand peintre !
Jean-Marie Barbe
Jean-Marie Barbe est réalisateur, producteur et porteur de projets dans le milieu du cinéma documentaire. Il est né à Lussas (Ardèche) en 1955. Il se passionne pour le cinéma dès son plus jeune âge. Dans les années 1970, il étudie les sciences humaines à l’université et s’engage dans des combats sociaux libertaires et écologiques qui le conduisent au documentaire "politique". Il nourrit alors la conviction de rester en milieu rural afin de le transformer par le cinéma. Il réalise plusieurs films et fonde en 1978, avec trois amis, l’association Le Blayou, dans le but d’organiser le festival "Cinémas des pays et régions" contre le centralisme parisien du cinéma. En 1979, l’association devient Ardèche Images. C’est sous l’impulsion de la Bande à Lumière et d’Ardèche Images que vont s'organiser les premiers États généraux du film documentaire en 1989. C’est le point de départ d’une activité tournée vers le cinéma à Lussas, activité qui se poursuit aujourd’hui à travers plusieurs structures. Jean-Marie Barbe continue également la réalisation. Son dernier film, coréalisé avec Arnaud Lambert en 2016, est consacré au cinéaste Chris Marker, "Chris Marker Never explain never complain".