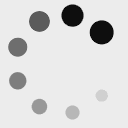Des chouettes à midi

« Je ne me suis jamais soucié du "sens de l’histoire" qu’en jouant délibérément sur le mot sens : il ne s’agissait pas d’une direction à suivre, d’un panneau indicateur planté par des chefs infaillibles (là encore, cette ambiguïté du mot "dirigeant" !), mais de la signification possible de cette histoire pleine de bruit et de fureur, racontée, etc. Si jamais j’ai eu une passion dans le champ politique, c’est celle de comprendre. Comprendre comment font les gens pour vivre sur une planète pareille. Comment ils cherchent, comment ils essaient, comment ils se trompent, comment ils surmontent, comment ils apprennent, comment ils se perdent... Ce qui d’avance me mettait du côté de ceux qui cherchent et se trompent, opposé à ceux qui ne cherchent rien, que conserver, se défendre, et nier tout le reste. » (Postface à Coréennes - Immemory - 1997)
Programmer une Escale dédiée à Chris Marker, cinquante ans après Mai 68, n’est évidemment pas un choix anodin. Cette Escale trouve d’ailleurs son écho dans la rétrospective et l’exposition "Chris Marker, Les 7 vies d’un cinéaste" qu’organise la Cinémathèque Française pour commémorer 1968.
Chris Marker a été, c’est un fait, une figure importante du cinéma engagé des ANNÉES 68. Anticipant les événements de Mai et les pratiques du militantisme cinématographique qui s’épanouiront alors, il a, dès 1967, participé à l’aventure des Groupes Medvedkine, ces ouvriers de la Rhodiacéta à Besançon, puis de Peugeot à Sochaux, devenus cinéastes pour pouvoir témoigner de la réalité de la condition ouvrière. La même année, il a coordonné le projet Loin du Vietnam, en opposition à la guerre impérialiste menée par les États-Unis, point de départ de l’aventure de la coopérative SLON-ISKRA. Soit une décennie d’expression collective et politique, sublimement ramassée en 1977 dans un film-somme, Le Fond de l’air est rouge (diffusé en mars et avril sur Tënk).
Mais au-delà de ces années d’incandescence, c’est toute son œuvre qui s’inscrit dans un long demi-siècle d’Histoire - la reflétant parfois, bien souvent cherchant à l’infléchir ou à la transformer. Cette Escale Marker en atteste, même si c’est de manière cruellement fragmentaire.
De l’éducation populaire et l’engagement "existentialiste" (Chris Marker a été l’élève de Sartre au lycée de Neuilly) dans l’après Seconde Guerre mondiale, à la lutte anti-coloniale (Les statues meurent aussi avec Alain Resnais, en 1950) et à la pensée écologique (Vive la baleine avec Mario Ruspoli en 1972 – bientôt sur Tënk), de l’ex-Yougoslavie au refus d’une pseudo "fin de l’Histoire", multiples ont été les formes de son engagement, que reflètent bien les grands temps de sa filmographie.
Mais Chris Marker ce n’est pas simplement une conscience fortement inscrite dans son époque, une curiosité politique toujours vive, c’est aussi un trajet de cinéaste de plus en plus nettement travaillé par le motif obsédant de l’Histoire. À ce titre, l’œuvre de Marker connaît à la fin des années 1970 (et ce film décidemment charnière qu’est Le Fond de l’air est rouge) un tournant. Cette œuvre, habitée depuis le début par le sentiment du temps et un certain sens tragique, s’épanouit et d’une certaine manière se rejoint elle-même : cet art de la distance qui a toujours caractérisé le regard markérien (amusé et détaché, parfois en surplomb) trouve son ton ou sa figure : le cinéaste se réinvente comme historien des images. Lui qui s’est essayé au cinéma direct en 1962 renoue avec sa véritable nature, celle d’un essayiste de nos imaginaires.
Son ultime projet, un ensemble d’installations resté inachevé et intitulé "Owls at noon" ("Des chouettes à midi"), s’inscrivait d’ailleurs pleinement dans cette trajectoire, puisqu’il ne s’agissait rien moins que de composer un voyage subjectif à travers le 20e siècle ! Des chouettes à midi, des oiseaux de nuit en plein jour : "attirer à la lumière des choses ou des êtres qui normalement n’y ont pas accès. S’attacher à des détails, à des choses infimes que dédaignent les historiens et les sociologues, et par leur maillage, arriver au portrait d’une époque." Et parvenir à une autre représentation, une contre-Histoire peut-être, qui ne soit pas nécessairement celle des vainqueurs.
Les films qui composent cette Escale (auxquels il faudrait joindre ceux qui ont été diffusé sur Tënk récemment) visent à retracer ces rapports variés d’un cinéaste à l’Histoire, comprise tout à la fois comme matière (toute une image est le "souvenir d’un avenir", une archive à revoir et à relire sans cesse), espace de référence (le cinéma, comme la discipline historique, est travail du temps) et "position" (un lieu d’où regarder les images, à distance - bien loin du désir d’immersion qui caractérise notre époque).
Le premier de ces films, Nuit et Brouillard, est signé par Alain Resnais. Mais on a voulu, en le joignant à cette Escale consacrée à Marker, rendre hommage à ce qui fut un temps nommé le "Groupe de la rive gauche", ce rassemblement informel de cinéastes (Agnès Varda, Alain Resnais, Chris Marker, Henri Colpi, Armand Gatti), soudé par l’amitié et plus attiré par le "réel" et l’Histoire, plus politisé également que la Nouvelle Vague. Le film exprime avec force cette volonté, propre au groupe, de se coltiner avec l’époque, d’en donner une représentation lucide et exigeante, à la hauteur de la gravité des événements. Marker, très proche de Resnais, a joué le rôle de conseiller, accompagnant l’écrivain Jean Cayrol dans l’écriture du commentaire (comme le racontent bien Sylvie Lindeperg et J.-L. Comolli dans le film Face aux fantômes - bientôt sur Tënk - qu’ils consacrent à Nuit et Brouillard).
Avec Le Joli Mai, et sous couvert de faire le portrait de Paris et de ses habitants, c’est à un autre pan de l’Histoire française que s’attaque Marker. La caméra et le micro descendent dans la rue pour capter la parole des gens à un moment bien particulier : le film est tourné quelques semaines après les accords d’Evian marquant la fin de presqu’huit ans de guerre en Algérie. Révolution du cinéma direct, que Marker s’approprie pour la première fois, pour saisir l’air du temps et la fin d’un monde (colonial).
Autre révolution quelques années plus tard, l’aventure Loin du Vietnam. Avec ce film collectif (au générique duquel on retrouve quelques noms déjà évoqués et d’autres bien connus : Resnais, Varda, William Klein, Jean-Luc Godard, parmi beaucoup d’autres bénévoles), orchestré par Marker, il s’agit là encore d’épouser la rumeur voire la colère du monde. L’agression contre le Vietnam mobilise les consciences de gauche tout autour de la planète et les cinéastes français en profitent pour inventer une manière politique de concevoir le cinéma, faisant voler en éclat la répartition traditionnelle des rôles et tout un système hiérarchique et économique de fabrication des films. Une partie du cinéma de 1968 et des collectifs militants s’inaugurent avec ce film d’intervention qui pourrait sonner comme le manifeste du cinéma moderne français.
Quelques mois plus tard, les événements de mai éclatent. Les cinéastes (les mêmes et beaucoup d’autres professionnels) se demandent comment accompagner la lutte : Chris Marker invente le cinétract. Des petits films courts de 3 minutes, sans son, réalisés en tourné-monté, pour relater ou exalter le moment présent de la lutte. Là encore, pas de signature d’auteur, un effort collectif, tout le monde au service de tout le monde, dans l’instant. On a choisit le Cinétract 005 pour ses accents markériens.
On enjambe la décennie politique pour atterrir en 1982 et découvrir l’ovni Sans soleil. Marker revient au film de voyage et à l’essai-filmé. Fuite dans l’ailleurs, loin du politique ? Pas du tout ! Enrichi par les années politiques, Marker renoue avec son premier style mais pour le sublimer. Méditation délicate sur l’existence et le temps, Sans soleil met en perspective les engagements passés, tirant les leçons de l’Histoire, si souvent tragique, et traçant les chemins de demain : naissance ces années-là des images digitales et nouvelles utopies des machines électroniques - sur lesquelles Marker jette un regard à la fois mélancolique ("Le Pac-man est la plus parfaite métaphore graphique de la condition humaine. Il représente à leur juste dose les rapports de force entre l’individu et l’environnement, et il nous annonce sobrement que s’il y a quelque honneur à livrer le plus grand nombre d’assauts victorieux, au bout du compte ça finit toujours mal") et tout à fait personnel ("Une écriture dont chacun se servira pour composer sa propre liste des choses qui font battre le cœur"). Marker regarde ses propres images et nous en parle comme revenu d’un autre monde.
Même principe au fond, avec le court métrage réalisé pour la CFDT pour fêter le centenaire du syndicalisme : plutôt que de commémorer la loi Waldeck-Rousseau de 1884, Marker nous projette dans le temps, cent ans plus en avant, en 2084. Réfléchir (ici, sur les différents scénarios d’un possible renouveau du syndicalisme) passe par le temps, un jeu sur les temps et l’Histoire, une fiction de science - là encore les machines et les ordinateurs sont enrôlés au service du rêve et de l’utopie. Puissances du faux !
Enfin, nous clôturons cette Escale par Le Tombeau d’Alexandre qui n’est pas simplement un monument élevé au cinéaste russe Medvedkine mais une riche réflexion sur presqu’un siècle d’histoire, courant de la révolution russe de 1917 (Medvedkine étant alors, aux côtés d’Isaac Babel, membre de la cavalerie rouge) jusqu’à 1991 et l’effondrement de l’URSS. Avec ce film doublement testamentaire, Marker clôt la fresque entamée avec Le Fond de l’air est rouge : l’espoir communiste, sinistrement parodié par le "socialisme réel", achève sa longue chute d’astre mort-né. Au fond c’est une histoire de cet imaginaire communiste - si puissant et si puissamment mis en scène par les cinéastes soviétiques -, un imaginaire qui l’a personnellement longtemps hanté, on pourrait même dire "gouverné", que Marker nous propose en racontant la longue existence de Medvedkine.
Arnaud Lambert, réalisateur