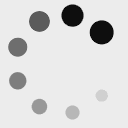Années 70 : des images se lèvent

 Années 1970. Dans les quartiers populaires de Cuba, au musée de l’Homme de Paris, à l’Université de Tunis, sur l’île de Gorée à Dakar, dans une chambre du foyer Sonacotra de Saint-Denis, dans les rues de Beyrouth en guerre, ou encore dans une cave de jazz en Pologne, des « images se lèvent », pour reprendre les mots de Assia Djebar.
Années 1970. Dans les quartiers populaires de Cuba, au musée de l’Homme de Paris, à l’Université de Tunis, sur l’île de Gorée à Dakar, dans une chambre du foyer Sonacotra de Saint-Denis, dans les rues de Beyrouth en guerre, ou encore dans une cave de jazz en Pologne, des « images se lèvent », pour reprendre les mots de Assia Djebar.
Nous avions envie de montrer ces films de colère qui inventent et prennent des formes inattendues. Les luttes sociales, féministes et décoloniales des années 1970 s’expriment ici par des souffles qui empruntent au lyrisme, au théâtre, à la poésie tragique, à l’exposé didactique, à l’absurde, au rêve, à la quête imparfaite et au tumulte. Un cinéma d’essai, indépendant, à la recherche d’une signification et d’une puissance politique libératrice qui naît de la stimulante hybridation de la fiction et du documentaire. Nous voulions lier ces étrangetés.
D’une certaine façon, c’est l’écrivaine et cinéaste algérienne Assia Djebar qui nous a soufflé ce programme. Ses écrits sur le cinéma qui vient chercher la vérité du documentaire dans le mensonge de la fiction nous ont portées pour imaginer cette constellation de gestes cinématographiques qui partagent un même souci : refuser les formes du pouvoir, ne s’aligner ni avec la fiction, ni avec le documentaire, célébrer l’imaginaire, ouvrir des espaces de luttes et appeler à la transformation du réel par les moyens du cinéma. Une furieuse quête de liberté qui ne se contente pas de dénoncer une situation de domination coloniale et patriarcale, mais propose des outils et positions qui peuvent permettre de s’en échapper en recomposant le réel.
La mise en scène fictionnelle dans l’écriture documentaire multiplie les possibles. Sarah Maldoror transforme les réserves d’un musée en espace de décolonisation culturelle (Et les chiens se taisaient). Jocelyne Saab ouvre un espace de paix dans une ville en guerre en remettant un bus en marche (Lettre de Beyrouth). Ali Akika et Anne-Marie Autissier lient les luttes de libération féministes avec les luttes autonomes de l’immigration, à travers la rencontre fictionnelle de deux personnages (Voyage en Capital), tout comme le fait Sara Gómez en s’attaquant à la fois aux discriminations de race, de classe et de genre (De cierta manera). Mahama Johnson Traoré s’affranchit des blessures de l’esclavagisme (Reou Takh). Salma Baccar et Mostafa Derkaoui proposent d’intervenir sur le réel en incitant à la lutte : féministe pour l’une (Fatma 75), et guérilla de libération pour l’autre (Un jour, quelque part).
Et ces images révolutionnaires (re)viennent à nous après un long cheminement dans les marges des histoires du cinéma où elles ont été trop longtemps reléguées. Trop expérimentales (ou pas assez), impossibles à classifier, parfois interdites car non conformes aux visions officielles de leurs pays, souvent réalisées par des femmes, racisées, et en dehors des réseaux dominants, ces œuvres nous arrivent aujourd’hui grâce au travail de celles et ceux qui ont su les regarder et s’emploient à en prendre soin, en les restaurant, en les programmant, et en écrivant. Ce travail de militance collectif et de mise en crise des histoires du cinéma canoniques est aussi celui qui nous anime à Talitha.
Avec l’espoir que ces gestes retrouvés des cinémas radicaux des années 1970 puissent apporter à nos présents et nos futurs un souffle nécessaire aux luttes qui continuent, en Palestine, en France, et ailleurs.
Léa Morin, Talitha